Corps brisés, esprits fragilisés : le vrai prix du cutting
- Malo
- 3 juil. 2025
- 7 min de lecture
Conor McGregor debout sur la balance avant son combat contre José Aldo : cette image choc de 2015 illustre une réalité bien connue mais trop souvent banalisée dans le MMA. Derrière l’exploit physique se cache une pratique aux conséquences dramatiques : le weight cutting. Cette perte de poids express, devenue un rituel avant les combats, met gravement en péril la santé des athlètes. Enquête sur une bombe à retardement que l’univers du MMA tarde à désamorcer.

Conor McGregor, les joues creusées, les côtes saillantes, les yeux cernés, debout sur la balance en 2015 avant son combat contre José Aldo. Ce n’est pas une image d’archives médicales, mais bien une pesée officielle de l’UFC. Comme des centaines d'autres combattants avant et après lui, "The Notorious" s'est infligé un weight cutting extrême, perdant jusqu’à 10 kilos en quelques jours pour entrer dans les 66 kg réglementaires des featherweights. Le lendemain, il montait dans la cage avec au moins 8 à 10 kg repris. Une transformation physique express, qui interroge autant qu’elle inquiète.
À mesure que le MMA se professionnalise, la question du weight cutting devient centrale. Si elle est tolérée, voire encouragée dans l’écosystème du sport, ses conséquences sanitaires, éthiques et sportives sont de plus en plus difficiles à ignorer. Le weight cutting n’est pas une simple stratégie : c’est une pratique systémique, dangereuse et souvent absurde, qui transforme le combat en une épreuve de survie avant même le premier coup porté.
Une pratique ancrée mais dévoyée
Le weight cutting, littéralement « coupe de poids », est un processus intensif qui consiste à perdre un maximum de poids avant une pesée officielle, pour ensuite le regagner avant le combat. La méthode est connue : réduction drastique des liquides, alimentation minimaliste, sauna, bains chauds, vêtements de sudation… L’objectif est de passer sous une limite de catégorie de poids donnée (par exemple 70 kg chez les légers), tout en combattant ensuite avec un avantage pondéral net une fois réhydraté.
Cette stratégie est apparue dans les sports de lutte, puis s’est institutionnalisée dans les sports de combat avec catégories de poids, notamment la boxe et le MMA. Elle est aujourd’hui largement banalisée, parfois considérée comme une compétence à part entière. Certains combattants bâtissent en partie leur carrière sur leur capacité à "cut" efficacement. Pour beaucoup de combattants, le cutting n’est pas un choix mais une étape stratégique imposée par la logique de compétition. L’idée d’un gain d‘avantage physique est profondément ancrée dans l’inconscient collectif du MMA.
Les exemples célèbres abondent, à l’instar de Khabib Nurmagomedov, considéré comme l’un des plus grands lightweight de l’UFC. Il pesait autour de 85 kg hors camp, avant de descendre à 70 kg pour ses combats. Son coach, Javier Mendez, a lui-même avoué avoir craint pour sa santé lors de certains cuttings.
Darren Till, combattant chez les welterweights, a reconnu peser 93 kg le jour du combat. « Je suis un light-heavyweight dans la division welterweight. Ça devrait être illégal », a-t-il avoué.
Une stratégie de déshydratation à haut risque
Contrairement à une perte de poids classique étalée sur plusieurs semaines, le weight cutting est une déshydratation aiguë contrôlée. En moyenne, un combattant professionnel coupe minimum 6 à 10 % de son poids en quelques jours, selon une étude de 2019 publié par Journal of the International Society of Sports Nutrition. Certains vont jusqu’à 15 %, un seuil critique pour l'organisme.
Le protocole débute souvent par une phase de water loading, où l’athlète boit jusqu’à 8 litres d’eau par jour avant d’arrêter brutalement toute hydratation. Il supprime ensuite le sel, les glucides et les fibres, afin de maximiser l’élimination d’eau. Viennent alors les bains très chauds, parfois salés, suivis de longues sessions de sauna en combinaison étanche. Dans les cas extrêmes, certains utilisent des diurétiques ou des laxatifs, malgré leur interdiction. Après la pesée, la réhydratation est rapide et parfois effectuée par voie intraveineuse, une méthode prohibée par l’Agence Mondiale Antidopage. Une polémique sur l’usage de cette méthode avait surgi pour le combat Makhachev vs Volkanovski 1, et une prétendue utilisation par Islam.
Ce processus brutal provoque une perte massive de sodium, potassium et magnésium, éléments essentiels à la contraction musculaire et au bon fonctionnement cardiaque. Le volume plasmatique diminue, tout comme les réserves de glycogène. Une étude menée par Yamamoto Nutrition a démontré qu’une déshydratation supérieure à 5 % entraîne une baisse significative de la puissance anaérobie et de la coordination motrice. Ces effets ne s’effacent pas totalement en 24 heures. Une autre recherche, dirigée par Coswig en 2015, a révélé un déséquilibre hormonal manifeste : augmentation du cortisol, baisse du ratio testostérone/cortisol. Ces marqueurs témoignent d’un stress physiologique intense, incompatible avec une performance optimale.
Des conséquences sanitaires et neurologiques dramatiques
La déshydratation extrême altère tous les équilibres fondamentaux de l’organisme. Elle peut entraîner des troubles cardiovasculaires, des problèmes rénaux, une fatigue musculaire intense, des troubles thermorégulateurs, et dans les cas les plus graves, des arrêts cardiaques ou des comas hypovolémiques.
Mais le cerveau paie le plus lourd tribut. La réduction du liquide céphalo-rachidien, véritable amortisseur naturel, rend le cerveau plus exposé aux chocs... Un paradoxe inquiétant dans un sport ou les athlètes se frappent à la tête. Une étude publiée dans l’International Journal of Sports Physical Therapy a mis en lumière le lien entre déshydratation cérébrale et risque accru de commotions. À impact égal, un cerveau déshydraté absorbe moins bien les coups, augmentant la probabilité de traumatismes.
D’autres recherches ont démontré qu’une perte de poids rapide entraîne un allongement du temps de réaction (jusqu’à 14 % chez les judokas), une altération de la prise de décision et une baisse de concentration.
Le témoignage de William Gomis, dont le combat à l’UFC 301 a été annulé, illustre ce danger : « J'ai eu mal au ventre, j’ai commencé à vomir, mon corps n’acceptait plus l’eau. [...] Mon manager m’a sauvé la vie. »
Une souffrance psychologique normalisée
Au-delà des effets physiques, le weight cutting impacte lourdement la santé mentale. Les combattants subissent des sautes d’humeur, une irritabilité constante, de l’anxiété, des troubles du comportement alimentaire (TCA) et des pertes de repères. Cette pression favorise les troubles du comportement alimentaire, entre restrictions extrêmes et épisodes de suralimentation incontrôlée.
Une étude de 2021 publiée par la National Library of Medicine, portant sur 166 athlètes de sports de combat, montre que ceux qui perçoivent les fluctuations de poids comme une menace présentent davantage de troubles alimentaires, d’anxiété et de dépression. Baki, interrogé par Clique, a résumé la situation : « Tous les combattants qui cut connaissent les troubles du comportement alimentaire. C’est trop intense. Certains doivent être tenus par la main pour ne pas faire de bêtises. »
Cette souffrance mentale est souvent minimisée, voire glorifiée dans la culture du MMA. Elle est perçue comme une preuve de dévotion, alors qu’elle relève d’une logique d’auto-agression, dangereuse et incompatible avec l’intégrité du sport.
« Les troubles du comportement alimentaire sont présents chez tous les combattants qui pratiquent le régime et le cutting. C’est trop intense donc ça crée de la frustration. Certains combattants doivent être tenus par la main sur ça parce qu’ils peuvent vite faire des bêtises” a déclaré Baki au micro de Clique.
Des tentatives de régulation encore marginales
Face à la gravité du phénomène, certaines initiatives émergent. En Californie, la commission athlétique (CSAC) a instauré en 2019 la règle dite des 10 %, recommandant une montée de catégorie si le combattant reprend plus de 10 % de son poids entre la pesée et le combat. Bien que non contraignante, cette mesure permet de mieux documenter les dérives. Mais, de nombreux combattants continuent d’ignorer ces recommandations. « Il n'est pas rare que les combattants de MMA reprennent entre 8 et 18 % de leur poids entre la pesée et le combat » avance Marc Raimondi.s
Le ONE Championship, de son côté, a mis en place une politique radicale : interdiction des coupes par déshydratation, tests d’urine réguliers, pesées multiples et suivi médical. Cette réforme est née après le décès d’un jeune combattant en 2015. Cette réforme a toutefois ses limites : elle impose une transparence rigoureuse, difficile à répliquer dans des circuits plus opaques ou moins dotés en ressources médicales.
Le fondateur de ONE, Chatri Sityodtong, a déclaré : « Nous avons perdu un jeune homme en 2015 à cause du cutting, et nous avons décidé que plus jamais cela ne devait arriver. »
La NCAA, lutte universitaire américaine, a également instauré un système efficace : pesées rapprochées du combat, tests d’hydratation, suivi du poids naturel. Ces mesures ont permis de réduire les pratiques extrêmes sans nuire à la compétitivité.
Enfin, certains experts recommandent la création de catégories intermédiaires. L’écart entre certaines divisions (ex. : 70 à 77 kg) pousse les athlètes à descendre le plus bas possible. Des divisions à 165 lb ou 195 lb pourraient atténuer cette pression. Mais l’UFC y est opposée, comme l’a répété Dana White, malgré sa reconnaissance du problème.
Le weight cutting est devenu un monstre invisible au cœur du MMA. Pratique tolérée, elle met en péril la santé, l’intégrité et l’équilibre même du sport. Sous couvert de compétition, les combattants sont poussés à une souffrance inutile, pour un avantage souvent illusoire.
Mais c’est peut-être le regard du public qui fera évoluer le plus durablement les choses. À mesure que les vidéos de combattants titubant à la pesée ou s’effondrant dans les vestiaires deviennent virales, l’opinion s’émeut. Ce que l’on acceptait hier comme une épreuve de courage est de plus en plus vu comme une maltraitance silencieuse et profondément dangereuse, tolérée au nom du spectacle. Les fans, comme les médias spécialisés, ont un rôle à jouer dans cette prise de conscience, en mettant en avant les performances d’athlètes compétitifs sans cutting drastique et en valorisant les organisations qui tentent de réformer. En définitive, sortir du piège du cutting ne se fera ni en un jour, ni par décret. Il faudra réconcilier performance et intégrité, dans un sport où la souffrance fait partie du décor, mais ne devrait jamais en être la norme.

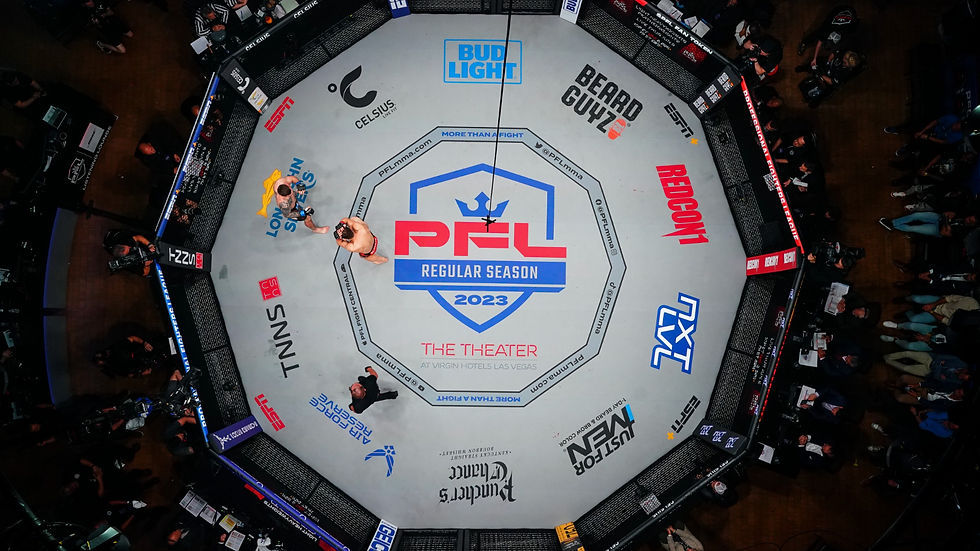

Commentaires